La poussée du populisme, du nationalisme et de l’extrême droite en Allemagne, et ailleurs en Europe, inquiète au plus haut point la journaliste franco-allemande Géraldine Schwarz.
“Cette montée de l’extrémisme menace les acquis du travail mémoriel réalisé en Allemagne et dans d’autres contrées d’Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Or, rejeter avec dédain ce travail de mémoire, comme le font aujourd’hui les hérauts des mouvements populistes et radicaux européens, fragilise la démocratie. Une forme d’amnésie historique est en train de gagner l’ensemble de l’Europe. Elle érode le consensus qui a été patiemment construit autour du combat contre le fascisme et les autres totalitarismes”, nous a dit Géraldine Schwarz en entrevue depuis Berlin.
En fouillant un jour dans les archives de son grand-père paternel, Karl Schwarz, elle a découvert une lettre que celui-ci avait reçue, en 1948, de Julius Löbmann, résidant à Chicago. Principal héritier d’une famille juive allemande ayant péri dans les chambres à gaz d’Auschwitz-Birkenau, Julius Löbmann lui réclamait réparation pour l’achat à rabais de l’entreprise de sa famille, spoliée par le régime national-socialiste. La transaction commerciale avait été effectuée en 1938, alors que les persécutions des Juifs s’intensifiaient.
La première réaction de Karl Schwarz fut de se retrancher dans le déni, refusant d’endosser ses responsabilités dans cet épisode sombre de l’histoire de l’Allemagne contemporaine.
À l’instar de la majorité des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, Karl Schwarz était un Mitläufer, un citoyen qui “marchait avec le courant”.
Adolf Hitler n’aurait jamais pu réaliser ses desseins macabres et mettre en œuvre le processus d’extermination des Juifs sans le concours et l’apathie des Mitlaüfer, rappelle Géraldine Schwarz dans le livre-enquête passionnant et très fouillé, Les Amnésiques (Éditions Flammarion), qu’elle vient de leur consacrer.
Dans cet ouvrage remarquable, qui se situe à la croisée du récit biographique et de l’essai historique, Géraldine Schwarz retrace avec brio l’histoire de sa famille franco-allemande —sa mère était la fille d’un gendarme sous le régime de Vichy— pendant et après la Guerre de 1939-1945.
Les Amnésiques est aussi une réflexion profonde sur l’avenir du travail de mémoire accompli par les Allemands depuis soixante ans. Géraldine Schwarz relate les combats homériques menés par des jeunes Allemands pour que leur pays affronte lucidement les démons de son passé.
LIRE AUSSI: UNE ENTREVUE AVEC L’HISTORIEN SAUL FRIEDLÄNDER
À une époque où les sirènes captieuses du populisme et des extrémismes ne cessent de séduire des citoyens désenchantés, Les Amnésiques est aussi une mise en garde fort salutaire contre les errances de la mémoire historique.
Journaliste, réalisatrice de documentaires historiques et ancienne correspondante de l’Agence France Presse (AFP) en Allemagne, Géraldine Schwarz collabore notamment avec le journal Le Monde, la chaîne de télévision franco-allemande Arte et à une émission politique de la télévision allemande, Deutsche Welle. Elle enquête depuis quelques années dans les Archives des services secrets allemands, BND. Elle vit à Berlin.
Est-ce le “devoir de mémoire” qui vous a motivée à écrire “Les Amnésiques”?
Il y a eu deux éléments déclencheurs. Un relevant de l’inconscient et un autre du conscient. Inconsciemment, c’est certain qu’on finit par être marqué par le milieu dans lequel on a grandi. Particulièrement quand on a été élevé au sein d’une famille franco-allemande et que l’on est le fruit d’un couple qui s’est rencontré après la Seconde Guerre mondiale et dont les familles respectives n’appréciaient pas toujours cette union.
J’ai été imprégnée par la certitude que la liberté, la paix et la démocratie, dont on jouit aujourd’hui, nous les devons au travail de mémoire qui a été réalisé depuis la fin de la guerre. C’est quelque chose de fondamental qui a beaucoup marqué ma génération. Or, assister aujourd’hui à la montée en force du populisme, des extrêmes droites et de partis politiques qui entretiennent un rapport très ambigu avec le passé, que ce soit le FPÖ (Parti de la liberté) en Autriche, l’AfD (Alternative pour l’Allemagne), le FN (Front national) en France ou des formations politiques d’extrême droite dans des pays d’Europe de l’Est, c’est indéniablement un phénomène très préoccupant.
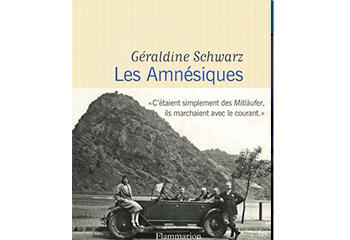 Vous déplorez l’amnésie historique qui sévit dans plusieurs pays d’Europe, notamment dans les contrées de l’Est.
Vous déplorez l’amnésie historique qui sévit dans plusieurs pays d’Europe, notamment dans les contrées de l’Est.
Je suis sidérée par cette amnésie ambiante qui banalise les épreuves atroces que l’Europe a traversées il y a moins de quatre-vingts ans. Force est de rappeler que les guerres effroyables qui ont ravagé le continent européen pendant la première moitié du XXe siècle sont la résultante d’idéologies abjectes qui, malheureusement, ont aujourd’hui à nouveau, à certains égards, le vent en poupe. Le constat de cette défiance vis-à-vis des démocraties m’a poussée à écrire ce livre.
Personnellement, j’ai l’impression que le monde dans lequel j’ai évolué, et auquel, comme mes parents, j’ai contribué, est sérieusement menacé. J’espère que le monde dans lequel j’ai grandi n’est pas Le monde d’hier, pour reprendre le titre d’un très beau livre de Stefan Zweig, mais sera aussi, en partie, le monde de demain.
En écrivant ce livre, je me suis posé des questions sur l’héritage historique que ma famille m’a légué, et qui est le fruit de l’éducation que j’ai reçue en Allemagne et en France. C’est certain que cet héritage identitaire n’est pas le même dans ces deux pays. J’ai pu les comparer durant mon éducation scolaire et mes parcours universitaire et professionnel en France et en Allemagne. C’est-à-dire, mesurer l’impact que le travail de mémoire réalisé en Allemagne et en France a eu sur l’avancée de l’esprit démocratique et la capacité des Allemands et des Français à résister aux extrêmes.
Cet écart au chapitre du travail mémoriel entre l’Allemagne et la France est-il important?
J’ai toujours été intriguée par la différence entre la France et l’Allemagne en ce qui a trait à l’avancée démocratique. C’est ce qui, depuis dix ans, me motive à creuser ces histoires de mémoire. Mais ce qui a suscité en moi l’envie de mêler l’histoire de ma famille à cette enquête sur le travail de mémoire, c’est le souhait impérieux d’amorcer une réflexion sur le rôle de mon grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale. La découverte inopinée de l’achat qu’il a fait, en 1938, d’une entreprise juive, alors que la persécution des Juifs battait son plein dans toute l’Allemagne, m’a bouleversée. Pour moi, cette transaction commerciale démontre non pas une implication directe de mon grand-père dans les crimes barbares commis par le IIIe Reich, mais une certaine complicité avec le régime nazi.
Mon grand-père incarne la figure du Mitläufer, qui est au cœur de mon livre. Les Mitläufer sont ces Allemands qui, ayant “marché avec le courant” pendant la guerre, considéraient à la fin de celle-ci avoir agi dans le cadre d’une “certaine légalité” et ne pas être responsables des crimes perpétrés par le régime nazi.
La figure du Mitläufer est universelle. Mon livre doit être aussi compris comme une mise en garde contre le danger de se conformer aux règles, à l’esprit et au politically correct ambiants. La menace qui nous guette: la multiplication de petits actes ayant l’air infiniment anodins, mais qui, pris séparément, peuvent mener à des crimes abominables comme ceux commis par les nazis. Ce qui me paraît fondamental, c’est de responsabiliser l’individu en l’encourageant à réfléchir aux conséquences de ses actes. Quand des millions d’individus posent le même type d’acte, les répercussions peuvent s’avérer parfois dévastatrices, surtout dans une démocratie.
Les Mitläufer occupent-ils une place importante dans le travail de mémoire realisé par les Allemands?
Les Mitläufer occupent une place primordiale dans le travail de mémoire, plus importante que celle des “monstres” nazis, qui font toujours la une des médias et sont omniprésents dans les films. Ces derniers portent l’étiquette de “monstres” parce que personne ne s’identifie à eux. Chose certaine, ce n’est pas à travers les récits sur les “monstres” nazis que l’on tirera de cette sinistre histoire les meilleurs enseignements pour éduquer les citoyens à la démocratie.
Dans votre livre, vous évoquez la participation d’une forte majorité d’Allemands à la spoliation économique des Juifs d’Allemagne.
L’aryanisation et la spoliation des biens juifs, qui a duré sept ans, est un chapitre majeur de l’histoire de l’Allemagne nazie. Malheureusement, ce chapitre a été négligé en raison de la prédominance de l’Holocauste dans l’historiographie consacrée à cette période noire. C’est un épisode important parce qu’il suit un processus sociétal progressif dans lequel de larges pans de la société allemande ont été impliqués. À partir de 1940, Hitler prend régulièrement la température de son peuple pour voir jusqu’où il peut aller. Pour sonder le seuil d’acceptabilité des Allemands, il ordonne la déportation des Juifs allemands sous leur nez. Pour accoutumer les citoyens à ce spectacle morbide, les forces de l’ordre veillaient à sauver a minima les apparences, en évitant la violence et en affrétant des wagons de passagers —et non des trains de marchandises, qui seront utilisés ultérieurement. Déjà, entre 1933 et 1939, toute une évolution sociétale s’était opérée, caractérisée par le pillage des biens des Juifs, auquel participe une majorité d’Allemands.
En Allemagne, le travail mémoriel a été un dur labeur qui n’a pas toujours fait l’unanimité.
En ce qui a trait aux responsabilités, il était impératif que l’État de la nouvelle République fédérale d’Allemagne (RFA) accepte, dans un premier temps, la responsabilité du lourd héritage que l’État de l’Allemagne nazie lui a légué. Sous la pression des Alliés, Konrad Adenauer, premier chancelier de la RFA, a tout de suite reconnu cet héritage. Il ne faut pas oublier que l’Allemagne a aussi fait son travail de mémoire parce qu’elle était soumise à la pression des Alliés, de l’opinion internationale et de la République démocratique allemande (RDA) qui, régulièrement, faisait état de scandales mettant en lumière la proximité de dignitaires de l’ancien État nazi avec le nouvel État de la RFA.
Mais, après les années 50, et malgré le fait qu’Adenauer a reconnu l’héritage légué par l’État nazi, la politique qui fut menée en a été une de déni total. À cette époque, gérer le passé, c’était l’oublier et, surtout, réhabiliter le maximum de personnes ayant été impliquées dans la mise en œuvre des politiques belliqueuses et antisémites du IIIe Reich. Sous Adenauer, des criminels de guerre ont été réhabilités. Le mot vergangenheitsbewältigung, qu’on peut traduire en français par “surmonter le passé”, hantait alors les Allemands. Une situation scandaleuse qui, à partir des années 60, a poussé la nouvelle génération d’Allemands à se rebeller.
Cette rébellion fut le prélude d’un travail mémoriel qui devint même obsédant.
Après avoir opéré un virage à 180 degrés, l’Allemagne a commencé à être obsédée par son passé. L’oubli céda alors sa place à l’obsession du passé. La nouvelle génération s’est mise à réclamer avec insistance la vérité. Elle s’est adressée frontalement aux Mitläufer. Mon père aussi a interpellé son père. Peu à peu, grâce à l’avancée de l’historiographie du IIIe Reich, qui est d’une excellente qualité en Allemagne et dans les pays anglo-saxons, mais des plus lacunaires en France, le passé noir de l’Allemagne a été exhumé et exploré exhaustivement.
On s’est alors rendu compte que les responsables qui avaient collaboré étroitement avec le régime nazi étaient beaucoup plus nombreux qu’on le pensait. Cet élargissement du cercle des responsabilités a permis aux Allemands de réfléchir sur leur responsabilité par rapport à leur passé. L’Allemagne a accompli un travail remarquable dans ce domaine des plus exigeants. Ce processus de conscientisation a été fondamental. En effet, vous retrouvez aujourd’hui, dans le comportement des Allemands, cette capacité à se responsabiliser dans tous les domaines, notamment en matière d’écologie.
Les Français par contre ont toujours eu maille à partir avec leur passé.
Les Français ont toujours eu beaucoup de mal avec le processus de responsabilisation d’un peuple vis-à-vis de son passé. La manière dont le rôle du régime de Vichy est, jusqu’à ce jour, enseigné en France est une preuve manifeste de l’indifférence des Français envers la vérité sur le comportement de leurs aînés pendant les années d’occupation nazie de la France. Pour ce qui est de Vichy, on responsabilise seulement l’État, le gouvernement de Vichy, la milice et les collaborateurs les plus connus. Les Français n’ont pas encore fait un dixième du travail de mémoire qui a été accompli par les Allemands depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il me semble qu’il est primordial de savoir pourquoi la moitié des Français avaient un portrait du Maréchal Pétain chez eux? L’adhésion au pétainisme était forte. Cette réalité a été éludée parce qu’en France, on a beaucoup de mal, pour des raisons électorales aussi, à mettre en cause le peuple. Récemment, Jean-Luc Mélenchon, leader du parti de la gauche radicale, La France insoumise, a affirmé que c’est la rue qui a libéré la France des nazis. Les Français ont créé un mythe sur leur passé, qui confère au peuple le rôle de héros. Le FN de Marine Le Pen tient aussi un discours analogue pour alléger la conscience des Français.
La récente entrée en force au Parlement allemand de l’AfD, un parti d’extrême droite, anti-immigration, anti-islam et anti-Europe, n’est-elle pas un signe de désaveu du travail de mémoire accompli par l’Allemagne depuis presque six décennies?
En septembre dernier, le résultat des élections législatives a fait prendre conscience aux Allemands qu’un mur subsiste encore entre l’Est et l’Ouest du pays. La percée électorale fulgurante de l’AfD a effaré beaucoup d’Allemands. Ces derniers se sont alors demandé pourquoi le score électoral de l’AfD à l’Est a été le double de celui réalisé à l’Ouest? Représentée désormais au Bundestag par quatre-vingt-treize députés, l’AfD est une formation politique plus dangereuse que les partis néonazis, qui sont mineurs et n’ont jamais fait élire de députés au Parlement de Berlin. L’AfD a engrangé 12,5 % des voix. Son entrée fracassante au Bundestag, qui a suscité de vifs débats dans la société allemande, est une première en Allemagne puisque jusqu’ici, grâce au travail de mémoire, on avait fait barrage à l’extrême droite. C’est une vraie césure historique, provoquée en grande partie par les électeurs de l’ex-RDA.
Donc, aujourd’hui, le populisme et l’extrême droite ont pignon sur rue principalement dans les régions et les villes de l’Est de l’Allemagne.
Je pense que le score historique de l’AfD aux dernières élections est la conséquence, entre autres, de l’absence de travail de mémoire dans la RDA. Pendant 40 ans, le régime de la RDA s’est accroché à un mythe complètement délirant: la population de la RDA, communiste, ne pouvait être l’héritière du IIIe Reich puisqu’elle a combattu farouchement le régime nazi. Cet argument est insensé car la RDA est née après la chute du IIIe Reich. Mais la RDA a fondé entièrement sur cet argument fallacieux l’absence total de travail de mémoire et de responsabilisation des Allemands de l’Est face aux crimes nazis. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que pendant quatre décennies, la RDA était un pays qui vivait en vase clos. Très peu d’étrangers y résidaient. Les Allemands de l’Est n’avaient pas le droit d’aller à l’étranger, à l’exception des pays du bloc soviétique. Il n’y avait donc aucune ouverture envers les autres cultures, ethnies ou religions. C’est la raison pour laquelle aujourd’hui, les pays de l’Europe de l’Est versent dans un populisme d’extrême droite assez inquiétant et dans une xénophobie manifeste. C’est le résultat désastreux d’un manque de familiarité avec le multiculturalisme.
L’arrivée d’un million de réfugiés, majoritairement musulmans, sur le sol allemand a certainement contribué à raviver le populisme et la xénophobie à l’endroit des immigrants.
L’arrivée massive d’un million de réfugiés a déclenché, surtout à l’Est, qui pourtant a accueilli moins de réfugiés que l’Ouest, des peurs et une xénophobie héritées de la RDA. On ne balaye pas quarante ans de dictature communiste et nationaliste du jour au lendemain. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’une population entière change de mentalité en l’espace de vingt-cinq ans. C’est ce que l’Allemagne a compris aux dernières élections. Cependant, la nouvelle génération d’Allemands née à l’Est, après la chute du mur de Berlin, a une vision différente car elle est plus proche du multiculturalisme à l’occidental que ne l’ont été leurs parents. Mais les Allemands de l’Est qui étaient adultes en 1989, année où le mur de Berlin a été abattu, ont vécu un traumatisme dont ils portent encore les stigmates. On a trop négligé à l’Ouest le séisme provoqué par la chute du mur de Berlin. Un pays entier, la RDA, a disparu de la carte. Le choc a été immense pour les Allemands ayant vécu sous la férule de la RDA pendant quatre décennies. Après l’arrivée d’un million de réfugiés sur le territoire national, beaucoup d’Allemands ont commencé à réaliser que le devoir de mémoire est arrivé à ses limites. Mais, malgré tout, je considère que le score de l’AfD aux dernières élections n’a pas été trop élevé. Imaginez un instant quel aurait été le score électoral du FN si la France avait accueilli en l’espace d’un an un million de réfugiés? Je préfère ne pas le savoir!
Avez-vous écrit ce livre en pensant particulièrement aux jeunes générations d’Allemands, de Français et aussi d’Européens?
Oui. Nous devons être très vigilants. Je ne cesse de rappeler que les nouvelles générations d’Allemands, de Français et d’Européens se sentent de moins en moins concernées par l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. L’amnésie historique qui prévaut aujourd’hui menace le consensus moral en Europe. Une manière de sensibiliser les jeunes générations est de déplacer le curseur sur l’après-guerre afin de leur montrer le travail qui a été réalisé par leurs grands-parents et parents pour arriver au monde dans lequel nous vivons. C’est un travail dont nous devons être fiers.
Les partis populistes et d’extrême droite, comme l’AfD, ne cessent de clamer que l’Allemagne doit se débarrasser au plus vite de ce fardeau qu’est le passé, car il nourrit un sentiment de honte, et amorcer un nouveau départ. Pour ces partis radicaux, il est temps de tirer un trait définitif sur le passé. C’est pourquoi l’entrée de l’AfD au Bundestag est un événement fort inquiétant. Le travail de mémoire, qui est un des socles de l’identité allemande, est aussi un élément stabilisateur en Europe. L’AfD réclame, sans la moindre gêne, la fin de ce travail de mémoire, qui a grandement contribué à l’édification d’une Allemagne démocratique. C’est une tendance délétère pour l’Europe entière. Comme l’Histoire est toujours instrumentalisée par ces partis populistes et d’extrême droite, il faut sans cesse leur opposer des contre-arguments. Un petit livre de la nouvelle droite allemande, le pendant intellectuel de l’AfD, paru en 2017, consacre un chapitre entier, soit un tiers de l’ouvrage, à la nécessité de mettre fin au travail de mémoire. C’est consternant!
La chancelière allemande, Angela Merkel, a dénoncé dernièrement la montée de l’antisémitisme dans son pays. Quelles sont les principales sources de l’antisémitisme dans l’Allemagne de 2018?
En Allemagne, en général, les manifestations antisémites sont organisées par des groupes musulmans qui, la plupart du temps, confondent Israéliens et Juifs. Cet amalgame se traduit souvent par des dérives antisémites. Je travaille aussi sur l’influence du IIIe Reich dans le monde arabe. L’antisémitisme dans le monde arabe est bien réel, même si la base de celui-ci est d’origine politique, c’est-à-dire la contestation de l’existence de l’État d’Israël. Malheureusement, les clichés véhiculés dans le monde arabe sont des clichés antisémites. Aujourd’hui, PEGIDA, parti anti-islam, et les groupes néonazis sont en déclin. L’AfD leur a volé la vedette. Il n’y a pas de dérives antisémites au sein de l’AfD, mais beaucoup de dérives anti-islamiques, qui frôlent souvent le racisme. Les principales cibles de l’AfD sont les réfugiés et l’islam.
La poussée de la droite populiste et de l’extrémisme musulman inquiète fortement la communauté juive d’Allemagne.
En Allemagne, les Juifs sont moins nombreux qu’en France. Aujourd’hui, la communauté juive d’Allemagne compte quelque 200 000 personnes. En France, il y a environ 500 000 Juifs. Dans la communauté juive de France, il y a une véritable inquiétude. De nombreuses familles juives quittent les villes de banlieue où elles ne se sentent plus en sécurité. Bien que la vigilance doit toujours être de mise, la situation des Juifs en Allemagne est moins préoccupante qu’en France. J’évoque brièvement dans mon livre l’antisémitisme français. Il a des racines très profondes. Je pense même qu’elles sont plus anciennes que celles de l’antisémitisme allemand. Malheureusement, l’antisémitisme est un fléau très européen qu’il faut continuer à combattre vigoureusement et sans relâche.





